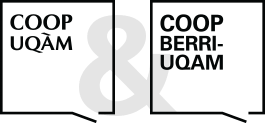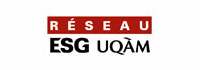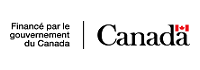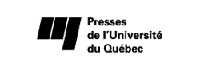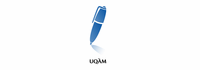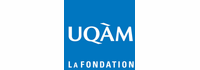Taille de l'homme
Éditeur : Editions Zoé
ISBN numérique PDF: 9782889071661
ISBN numérique ePub: 9782889071654
Parution : 2022
Catégorisation :
Livres numériques /
Autre /
Autre /
Autre.
Formats disponibles
| Format | Qté. disp. | Prix* | Commander |
|---|---|---|---|
| Numérique PDF Protection filigrane*** |
Illimité | Prix : 8,99 $ | |
| Numérique ePub Protection filigrane*** |
Illimité | Prix : 8,99 $ |
*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
***Ce produit est protégé en vertu des droits d'auteurs.
Description
Avec Taille de l’homme, Ramuz examine différentes formes d’organisations sociales pour souligner le caractère universel de la condition humaine, rendu plus évident à ses yeux par la mondialisation. Christianisme, bourgeoisie, communisme, matérialisme, autant de concepts que Ramuz déconstruit pour renouer, dans un mouvement néo-rousseauiste, avec une pensée proche de la nature, à taille humaine. « Qui sommes-nous encore dans notre taille, nous autres hommes ? Quelle est encore notre mesure, alors que l’univers est chaque jour et en tout sens plus minutieusement mesure?? ? » La renommée de Ramuz est confirmée au cours des années 1930, en France comme en Suisse. Côté roman, c’est la décennie de Farinet (1932), Derborence (1934), de Si le soleil de revenait pas (1937). Parallèlement, Ramuz publie des essais, Taille de l’homme (1933), Questions (1935) et Besoin de grandeur (1937). Il y médite sur les valeurs qui peuvent fonder l’existence, y scrute les faiblesses des sociétés de l’époque, capitalistes, fascistes ou communistes. Les années 1930 voient la montée du fascisme et du nazisme, le renforcement du communisme et les balbutiements de la mondialisation. En parallèle, la société paysanne, soudée à la nature, et avec elle le monde ancestral tel que Ramuz l’a décrit dans Aline, sont en passe de changer profondément. Taille de l’homme est l’occasion pour Ramuz de faire le point sur ces mouvements qui bouleversent la condition humaine : « Le drame véritable est que l’homme n’a plus de taille, étant sans commune mesure avec l’univers matériel, et, sur le plan de la conscience, sans rapports avec un monde où il ne la retrouve nulle part. De par ses dimensions extérieures et intérieures, rien n’égale la solitude qui est la sienne, au milieu de tout ce qui l’entoure, de tout ce qu’il pense, de tout ce qu’il sent. […] Qui sommes-nous encore dans notre taille, nous autres hommes ? Quelle est encore notre mesure, alors que l’univers est chaque jour et en tout sens plus minutieusement mesure?? ? » Pour dresser le bilan, Ramuz passe en revue différentes formes d’organisations sociales : christianisme et paganisme, bourgeoisie, soviétisme, matérialisme, autant de concepts que Ramuz déconstruit avec la clarté d’esprit et l’élégance littéraire qu’on lui connaît pour redonner à l’humanité une échelle appropriée. Face au monde moderne, Ramuz ne prône pas pour autant un retour en arrière, il s’intéresse aussi aux découvertes et aux évolutions techniques. Cependant, il met en garde contre la passivité qui découle d’un progrès trop extrême, contre la machine qui impose un intermédiaire systématique entre l’homme et la nature. D’une rigueur philosophique, Ramuz se fait par moment lyrique pour évoquer les mythes ancestraux enracinés dans l’environnement, d’où ont surgi les divinités païennes. Avec une verve rousseauiste, il rappelle l’importance de la nature et du monde rural – l’homme véritable, c’est le paysan, qui vit à taille humaine. L’État moderne « L’homme n’a plus à se demander quelle est sa taille, car il n’y a plus aucune réponse possible à sa question ; il a à se demander quel est son rôle, son rôle dans la société. L’Etat, qui est la société, ou la société, qui est l’Etat, car les deux choses n’en font plus qu’une, est seul à avoir une existence ; l’individu n’est qu’un de ses organes : peut-être même serait-il plus juste de dire un de ses rouages, cette forme de l’Etat étant bien, semble-t-il, plus mécanique qu’organique. L’Etat ne considère dans l’individu que son utilité, son rendement quotidien. » La bourgeoisie « Le tragique de la condition bourgeoise est qu’elle reste attachée à certains avantages, qu’elle a mérités une fois peut-être, mais qu’elle ne mérite plus. Les bourgeois sont donc obligés aujourd’hui de se prouver à nouveau, par un sursaut d’activité, qu’ils ne sont pas indignes de leurs privilèges : d’où le fascisme. Ils peuvent, en effet, au fond de leur peur même, trouver un regain d’énergie, qui sera de nature à les tromper un instant sur leur sort. Mais ils ne peuvent pas empêcher que la doctrine qui est la leur, ou qui du moins a été la leur, étant révolutionnaire à l’origine, n’aboutisse à une nouvelle révolution, qui s’inspirera d’eux tout en se faisant contre eux. » Le communisme « L’idéologie communiste prend bien soin de vous persuader qu’il n’y a rien. C’est une Eglise, c’est une parodie d’Eglise. Elle seule connaît, décide et enseigne. […] Le communisme s’aime lui-même et puis c’est tout : il prétend donc qu’on n’aime que lui. Ce qu’on propose à l’homme c’est l’adoration d’une idéologie ; c’est même la seule chose qu’il lui soit permis d’adorer. » Le matérialisme « L’homme, quel qu’il soit, a les mêmes fonctions, donc les mêmes besoins matériels, les seuls qui comptent ; et c’est, en gros, de vivre, au sens matériel du mot, c’est-à-dire qu’il a besoin avant tout d’une certaine quantité de nourriture ou, plus scientifiquement encore, d’un certain nombre de calories. […] Le matérialisme fonde ainsi la société sur un type d’homme tout abstrait, l’homme standard, un homme dont on n’a retenu et qui ne représente qu’une valeur quantitative, sur quoi on fonde sa ressemblance : un homme tout à fait en somme antinaturel. » La technologie « « Il ne serait peut-être pas non plus très difficile de montrer que plus l’homme progresse dans la conquête de ce qu’il faut bien appeler ses pouvoirs seconds, qui sont d’espèce mécanique, plus il recule dans la possession de ses pouvoirs premiers, qui sont d’espèce intuitive et qu’il va sans cesse déperdant. […] la machine est admirablement faite pour flatter l’orgueil de l’homme, car elle lui dit : « Bientôt tu ne travailleras plus de tes mains. » Mais en même temps elle lui dit : « N’oublie pas que c’est toi qui m’as faite », et l’orgueil de l’homme croit que c’est vrai et l’orgueil de l’homme voit encore qu’il va la perfectionner (la machine). Où s’arrêtera ce perfectionnement ? se dit-il. Grâce à elle (la machine) qui vient de moi, et sinon telle qu’elle est, du moins telle qu’elle sera bientôt, je vais supprimer la nature, et, là où elle est hors de mon atteinte, je la supprimerai par d’autres moyens, – en la comprenant. […] Jamais l’homme n’a été plus en butte à l’universel qu’aujourd’hui, même quand il se tient bien tranquille dans son coin ; aujourd’hui, l’univers vient l’y chercher. Le monde autour de lui est dans un déplacement continuel, de plus en plus rapide, de sorte que le monde est comme sans cesse présent tout entier dans un de ses points. L’auto, l’avion, la T. S. F., le cinéma ; les images, les bruits, les voix. L’homme n’a plus à faire, il n’a qu’à se laisser faire. La réalité qui l’assaille surpasse de beaucoup en richesse ses plus folles imaginations. Mais, en même temps, il se sent devenir petit, et de plus en plus petit, à cause de sa passivité même. Il devient de plus en plus passif ; la réalité de plus en plus active. » La nature belle et sacrée « Le paysan grec, quand il levait la tête vers les montagnes, apercevait Vénus dans les vapeurs roses du matin, pas beaucoup plus grande qu’une femme d’homme. L’orage survenait : c’étaitJupiter qui agitait ses foudres, parfaitement visible à l’horizon. Vulcain forgeait ses armes, Junonfronçait le sourcil. Rien, chez les dieux, que l’homme ne pût connaître immédiatement, n’étant que prolongé par eux, car leurs actions étaient des actions d’hommes, et leurs passions étaient des passions d’hommes, et ils étaient liés entre eux par des liens de parenté, au-dessus des hommes liés entre eux par des liens de parenté : – pères et fils, de part et d’autre, mères etfilles, maris et femmes, jaloux, amoureux, envieux, haineux. Quelrepos pour l’esprit de les considérer tout autour de soi dans le bel ordre de leur dynastie, comme on peut le faire aujourd’hui encore dans nos montagnes, car les dieux sont nés des montagnes et c’est dans les montagnes qu’ils se sontréfugiés. On les y salue encore au passage, de temps à autre, s’étonnant de les y retrouver, et non pas allongés dans des textes, ni ensevelis dans des livres, mais tout debout encore et tout vivants, offerts aux yeux. Je me rappelle ce beau matin d’été où nous roulions vers les portes du Valais, longeant le Rhône. Comment faire sentir l’extraordinaire mélange de repos, de fraîcheur, de silence et de pureté qui composait l’atmosphère de ces lieux ? Comment dire les vertus de l’air, et qu’il faisait limpide et qu’il faisait clair et qu’il faisait sombre ? Ah ! comme il faisait rose et bleu, tandis que nous passions de la lumière à l’ombre, et que larosée sur les feuilles était comme un peu de farine blanche. Iln’y avait personne, tout était dans le repos. Deux chaînes rapprochées, l’une à votre droite, l’autre à votre gauche, montent à près de 3000 mètres d’un seul élan, magnifiquement taillées, et comme de manière à présenter toutes les variétés et toutes les possibilités de la taille sur leurs fortes et larges assises, assombries dans le bas par les forêts. Et, là-dessus, du rose, du jaune, de l’or, de l’argent. On voyait ces rochers, on lesvoyait plus, mais on en voyait d’autres. C’étaient des pyramides, c’étaient des colonnes, vues, disparues, reparues ; c’étaient d’immenses piliers ou de larges frontons aux angles surplombants comme sur le devant d’un temple ; et, dans cette composition sans cesse défaite et refaite par le rapide avancement de la voiture, tout là-haut et sans base, parfaitement aérienne, soutenue par rien, avançant jusque sur la plaine, au-delà de tous ces étages d’éboulis, de ravines et denévés, il y avait une magnifique tête casquée qui s’est penchée un peu vers nous, pleine de curiosité, voulant nous voir sans doute et j’entends nous, les hommes, avec nos inventions, avec nos mécaniques, avec nos vêtements de drap anglais ou écossais, nos châles, nos manteaux. L’aigrette de son casque était de diamant, son casque demétal poli ; et safigure toute dorée était tournée vers nous à plat, nous observant, comme quand un chasseur de chamois occupe son poste, couché sur le ventre, – à 2500 mètres au-dessus de nous. Elle est là, regardez, elle est bien là, c’est bien elle ; – ellen’est plus là. Car elle nous avait déjà été reprise par le mouvement même des crêtes qui se déplaçaient les unes devant les autres, au-dessus de nous, tandis que la route elle-même change à tout moment de direction : – mais alors c’est Iris qui est parue, Iris messagère des dieux. Tout à coup elle était descendue vers nous à travers les airs d’unvol oblique ; la rapidité de sa course tendait tout son corps sous ses voiles, de sorte qu’il faisait une ligne droite du sommet de sa tête à la pointe de ses orteils. Elle aussi, elle était sortie des manuels où elle est morte ; elle rentrait dans la vie où elle se meut avec tant d’aisance, en même temps impondérable et ayant une masse, corporelle et aérienne, indéfinie et limitée : de diverses couleurs, et tout en nuances changeantes, la rigidité de son corps, qui était à leur centre, donnant seule à son vol une direction précise, marquant un but, une intention. C’est le soleil qui se montrait dans une étroite ébréchure de la chaîne à notre gauche, et nous envoyait sa lumière par brusque délégation. Ce dernier mot est le seuljuste. Un véritable message se faisait du soleil à nous. Hâte-toi, est-il dit, fais vite ! Et Iris fait vite et se hâte ; c’est une flèche, elle nous frôle au passage, mais nous sommes déjà passés. La mythologie grecque est née dans les montagnes : il faut aller dans les montagnes, si on veut la revivre, ce qui est la seule manière de la comprendre. J’étaisen pleine mythologie, je ne l’avais pas cherchée, elle s’imposait à moi. Car nouscontinuions à rouler, mais quelque chose roulait également au-dessus de nous sur la pente qui devenait de plus en plus sauvage, de plus en plus nue et escarpée ; c’était le bruit que font les maçons quand ils déplacent et entre-heurtent de grosses pierres ; et ainsi j’ai compris que les Titans, qu’on ne voyait pas, étaient toujours occupés à leurs monstrueuses besognes. Puis la pente devient tout à fait raide, ce n’était plus qu’une paroi, et, en même temps qu’une fine poussière d’eau nous était soufflée au visage, un rire de femme s’est fait entendre, auquel beaucoup d’autres rires de femmes ont tout à coup répondu. Il y a eu alors une fuite éperdue, tandis que nous paraissions sur la route à leur vue : c’étaient les nymphes du torrent qui, surprises par nous, remontaient à la hâte dans le bouillonnement de l’eau vers le haut des rochers d’où elles étaient descendues. Elles étaient là, on les voyait ; elles remontaient avec des rires la cascade où elles se suspendaient des deux bras, bougeant les genoux. Ellesétaient un grand nombre, elles avaient des robes de mousseline blanche, elles étaient les unes au-dessus des autres ; et tantôt elles grimpaient vite, tantôt elles s’arrêtaient, tournant la tête de notre côté. Puis elles recommençaient à grimper, en s’aidant l’une l’autre, puis cessaient de grimper ; alors le courant d’air soulevait leurs tuniques qu’il faisait flotter en avant d’elles dans les airs et qu’il effilochait du bout, pendant qu’appliquées à la roche, elles se remettaient à rire… Hélas! nous arrivions déjà dans une région peuplée d’hommes, avec des maisons, des rues, des boutiques, des usines, des cheminées qui fumaient noir au-dessus de nous par une espèce de trahison. Et les dieux avaient disparu, mais ils n’en avaient pas moins été parmi nous, pour un peu de temps, ce matin-là, j’entends chez eux et nous chez eux, régnant sur les hautes montagnes où il n’y avait aucun bruit qui ne fût leur bruit, aucun mouvement qui ne fût issu d’eux, solennels et familiers, heureux d’être, tout peints des plus belles couleurs, prodigieusement élevés autour de nous et grands, – pas tellement grands toutefois, ni si élevés qu’ils échappassent à nos mesures. Ils étaient seulement plus grands que nous, – mais ils étaient encore nous. Avec des bras, des têtes, des corps, des jambes, etdes vêtements sur ces corps, ou bien nus, mais nus comme nous. Car Vénus est nue et Artémis est vêtue. Vénus est rose, Artémistoute blanche. Iris est de toutes les couleurs. Les nymphes ont des tuniques de mousseline et voyez encore là-haut, celle qui est si majestueusement assise dans une robe bien drapée, la main sous le menton, dominant toute l’assemblée ; c’est Junon, mère des dieux. Calme, paix, pureté, sécurité, – sécurité surtout, car tout s’explique en même temps que tout est en vie et il n’y a rien dans le monde qui ne soit fait des mêmes éléments dont nous sommes faits nous-mêmes, au-dehors comme au-dedans, quant aux formes, quant aux sentiments, quant aux attributs, quant aux dispositions, quant aux gestes ou aux humeurs, – ayant de la peau, ces dieux, ayant des barbes ou point de barbes, ayant nos rires, ayant notre voix, ayant nos tridents, nos manteaux, ayant nos sceptres et nos arcs, nos rires, nos pleurs, nos désespoirs, nos joies. Et ils sont au sommet du monde, qu’ils achèvent ; ils sont aux extrémités de l’univers comme à son centre ; ils commandent non seulement à la terre et aux eaux, mais à l’air et aux arbres, détenant tout l’espace qui est à leur mesure et eux sontà la nôtre. » La collection « C. F. Ramuz » Voici une série de volumes afin de rendre hommage à l’écrivain le plus important de Suisse romande. Parfois considéré à tort comme un glorificateur du terroir, C. F. Ramuz est avant tout un inventeur de formes romanesques, un explorateur des registres et des ressources de la langue, un essayiste en décalage, un nouvelliste hors pair, comparable à un Picasso. À travers des titres choisis par Daniel Maggetti et Stéphane Pétermann, préfacés et annotés par des critiques aux horizons variés, cette collection ouvre l’accès à des textes peu connus, mais fait aussi découvrir autrement les œuvres emblématiques de l’auteur. Charles-Ferdinand Ramuz est l’écrivain le plus important de Suisse romande. Né en 1878 à Lausanne, il fait des études de Lettres puis s’installe pour dix ans (1904-1914) à Paris où il étudie à la Sorbonne, fréquente Charles-Albert Cingria, André Gide ou le peintre René Auberjonois, écrit entre autres Aline (1905), Jean-Luc persécuté (1909), Vie de Samuel Belet (1913). Dans ces premiers romans, les thèmes ramuziens tels que la solitude de l’homme face à la nature ou la poésie des terres, des vignes et du lac, sont déjà présents. En 1914, Ramuz, encore considéré comme un écrivain du terroir à Paris, revient en Suisse et s’installe parmi les vignes du Lavaux, d’où il ne bougera plus. Là, il rédige le manifeste des Cahiers vaudois.revue, autant que maison d’édition, réunit les créateurs majeurs de Suisse romande (Cingria, Ernest Ansermet, René Auberjonois, Gustave Roud), mais aussi Romain Rolland ou Paul Claudel. La production de Ramuz occupe le quart de la quarantaine de Cahiers qui paraîtront jusqu’en 1919. L’écriture de Ramuz devient dès lors plus révolutionnaire, il abandonne la narration linéaire et la multiplication des points de vue et adopte souvent un narrateur collectif et anonyme, « on ». Ses romans parlent d’ordre et de transgression, de création et de destruction, d’ouverture et de fermeture. Son écriture audacieuse lui valent des critiques de ceux qui lui reprochent d’écrire mal « exprès ». Pendant cette période il rédige entre autres L’Amour du monde (1925) et La Grande peur dans la montagne (1926), qui marquent l’apogée de sa carrière littéraire. Dès 1924, Grasset publie les livres de Ramuz et lui assure ainsi un succès auprès des critiques et du public. Entre 1929 à 1931, il dirige la revue Aujourd’hui. Dans les dernières années de sa vie, il s’essaie également à des textes politiques et autobiographiques, avant de s’éteindre à Pully en 1947. Son œuvre est aujourd’hui publiée dans la collection de la Pléiade. Préfacier Reynald Freudiger est enseignant, écrivain et chercheur spécialiste de Ramuz pour le Centre de recherche des lettres romandes.
Du même auteur...
| Livre papier | 1 | Prix : 8,99 $ |

Taille de l'homme
Éditeur : Editions Zoé
ISBN : 9782889071654
Parution : 2022